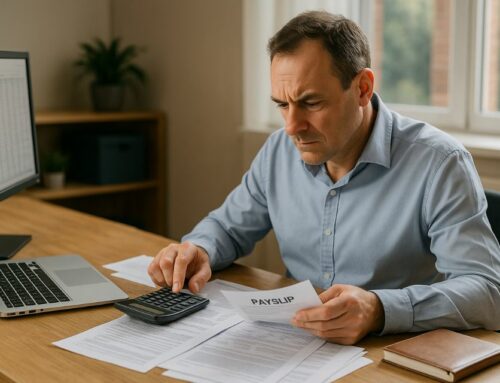Sous les caténaires suisses, chaque minute d’arrêt doit être planifiée avec rigueur pour protéger les équipes près des voies. Le coordinateur de chantier orchestre cette vigilance collective en combinant connaissance réglementaire et sens du terrain. Grâce à son pilotage, les trains continuent de circuler et les ouvriers avancent sans se mettre en danger, même sur les tronçons les plus fréquentés. Comprendre son rôle permet de mesurer l’envergure des responsabilités qui se concentrent dans cette fonction.
Le coordinateur de chantier : pivot des travaux ferroviaires helvétiques
Le métier de coordinateur de chantier découle de la fonction de chef de la sécurité définie par la prescription R RTE 20100. Lorsque plusieurs équipes interviennent simultanément sur une même section de voie, la gestion se complexifie. Le coordinateur centralise les consignes, fixe les itinéraires de dégagement et valide les créneaux d’interruption avec le régulateur ferroviaire. Il anticipe la venue des convois grâce aux données du centre de contrôle et organise l’évacuation en cas d’imprévu. L’activité couvre aussi la tenue du journal d’événements : heures de coupure, validations des protections, compte rendu final transmis aux CFF. En synthèse, cette figure assure que chaque trade interagit dans un cadre harmonisé sans compromettre la circulation des trains ou la sûreté du personnel.
Une expertise fédérée pour harmoniser les équipes
Sur un chantier ferroviaire, plusieurs disciplines se côtoient : électrification, voie, signalisation, génie civil. Le coordinateur traduit les attentes de chacune afin d’éviter les interférences entre tâches. Parce qu’il collabore en permanence avec des experts en sécurité ferroviaire Suisse, il bénéficie d’une vision multidisciplinaire qui dépasse l’application réglementaire. Cette coopération permet de caler les mesures protectrices dès la phase de planification, puis de les adapter aux aléas d’exploitation. Au quotidien, le coordinateur visite les zones actives, vérifie la visibilité des signaux d’avertissement et s’assure que les voies gardent la distance d’éloignement imposée par le RTE 20100. Lorsque la météo se dégrade ou qu’un train supplémentaire est routé, il redéfinit les priorités et relance les interlocuteurs pour préserver la sûreté collective.
La conformité au RTE 20100 garantit une marge de sécurité stable
Le référentiel R RTE 20100 détaille les signaux de cantonnement, les distances d’éloignement et les responsabilités durant les travaux. Le coordinateur le maîtrise afin d’établir un dispositif adapté à la topographie locale. Avant l’arrivée des équipes, il étudie les diagrammes de trafic et propose des créneaux de coupure réalistes au régulateur. Puis il contrôle la mise en place des balises, tonals et barrières légères prévues au plan. Pendant les opérations, il renseigne le registre informatique de contrôle, accessible aux inspecteurs de l’Office fédéral des transports. Cette traçabilité renforce la confiance entre exploitant et entreprises tierces, car chaque activité demeure consultable en cas d’audit et permet d’ajuster les consignes pour les futures interventions tout en limitant les incidents sur le réseau.
Communication temps réel avec les CFF et l’OFT
Le coordinateur ne reste jamais isolé ; il échange en continu avec le régulateur CFF, les services de maintenance et, si besoin, l’Office fédéral des transports. À l’aide d’une radio et d’une liaison de données, il transmet le statut des coupures, signale les retards et réceptionne les alertes de circulation. Cette boucle d’information garantit que les conducteurs de train reçoivent la vitesse limite actualisée et que les équipes entendent la consigne d’évacuation au bon moment. En outre, le coordinateur organise des réunions flash en bord de voie pour réévaluer le planning dès qu’un changement d’horaire intervient. Cette réactivité maintient la fluidité du trafic tout en protégeant chaque intervenant, même sur des lignes exploitées à haute fréquence comme le corridor Lausanne–Genève.
Se former et retourner sur le terrain pour progresser
La mission de coordinateur demande une actualisation constante des connaissances, car la version 7 du R RTE 20100 publiée en novembre 2023 introduit de nouveaux schémas d’éloignement. Les CFF imposent une certification renouvelée tous les trois ans, basée sur des scénarios pratiques évalués sur simulateur. Le coordinateur analyse les rapports d’événements et partage les enseignements avec les chefs de la sécurité. Ces retours de terrain alimentent les formations internes, améliorant la mise en place des protections et la communication intersectorielle. Parallèlement, la montée des systèmes d’alerte connectés demande de maîtriser des logiciels gérant la géolocalisation des opérateurs. Maintenir ce niveau d’exigence garantit une culture partagée, où chaque intervenant sait comment réagir face à un imprévu ou une modification de planning.
Sans coordinateur, la cohabitation entre trains et manutentionnaires deviendrait imprévisible, exposant chacun à des risques que la législation suisse cherche pourtant à bannir depuis des décennies. Cette fonction concentre la surveillance technique, la concertation humaine et la trace documentaire indispensables à la cohésion entre opérateurs publics et entreprises privées. En restant au carrefour de ces responsabilités, elle favorise la fluidité des chantiers et préserve la ponctualité des voyageurs sans sacrifier la sûreté.